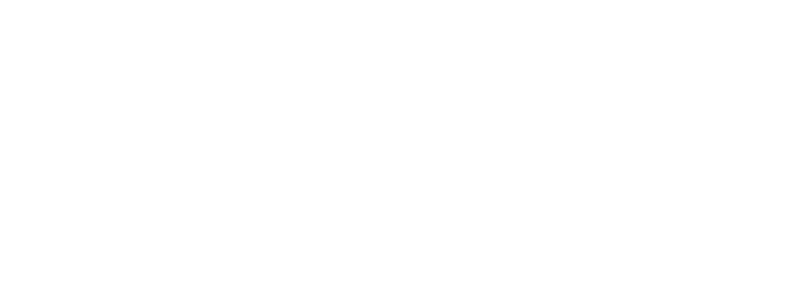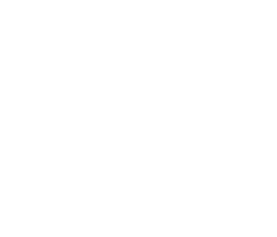Dianne Reeves + Benjamin Lackner Quartet
À l’heure où les chiens marchent sur leurs langues (il fait une telle chaleur qu’elles pendent jusqu’au sol), et où l’ennui de vivre chez les grands romantiques atteint son paroxysme (au-delà de 32 degrés Celsius, leurs cerveaux se noient dans la sueur), le théâtre Silvain ouvre ses flancs résineux au public venu voir, pour cette nouvelle édition du Jazz des Cinq Continents, le Benjamin Lackner Quartet et Dianne Reeves. En faction sur les hauteurs, dominant ce trou de verdure, les hôtels particuliers, villas et petits immeubles s’attendent à écouter, placides, le concert à venir. Le ciel est encore bleu, et sur sa toile, les avions dévalent à intervalles réguliers vers Marignane. Ça sent la sudation sèche, le frais, les sable, la résine et le miel du parfum de Gina. Le public est bien différent de celui que l’on croise au Molotov. Par contre, c’est bien l’équipe de cette salle qui tient la buvette. Avec Gina, on tique sur les cordons qui retiennent nos accréditations, car il y a marqué [censuré] dessus. [Censuré], toujours dix wagons de retards, on se marre. Jingle Jazz. Le directeur artistique du festival vient saluer l’audience, présente le programme. Tandis que les oranges du crépuscule commencent à s’installer, les musiciens du Benjamin Lackner Quartet font de même. Musique.
Déniché par les flaireurs des Editions de la Musique Contemporaine, label allemand aux visions depuis longtemps prophétiques, l’échine cassée sur son clavier, monsieur Lackner fait sortir des notes galactiques de son piano à queue. Parfois espacées, parfois en pluies de météores. Le bourdonnement des vols long courrier au-dessus de nous vient s’intercaler entre les touches, revenant toujours, comme un tamboura, soutenir la mélodie plutôt que la couvrir. Elle trace des coups de pinceaux qui ne sont pas sans évoquer des paysages de Californie ou de Sud-Ouest de la France. C’est bien simple, le saxophoniste Maciej Obara invoque et fait sortir du sol de longues avenues bordées de palmiers, le bassiste Jérôme Regard pose sur la ligne d’horizon des cumulus d’une blancheur douillette. Au volant de la Ferrari rouge décapotable d’Out Run, une blonde cheveux au vent sur le siège passager, le moteur ronronne, doux, et réglé au micro poil. C’est la batterie de Manu Katché, qui rebondit sur les cordes de la contrebasse avec une souplesse depuis longtemps légendaire. Il joue d’une manière si feutré, avec le doigté presque aquatique d’un filet d’eau tombant sur des galets, qu’on a du mal à se rendre compte du haut degré de maitrise nécessaire pour produire un art aussi subtil, dont les autres musiciens se révèlent tout aussi nobles artisans. C’est un véritable cliché que j’écris ici, mais tout à l’air de couler si facilement, qu’on en oublie la mécanique et les rouages mis en action pour faire tourner cette incroyable machine que l’on appelle la musique. Dans le cas de Katché ses membres sont des murènes : ils surgissent vite, mordent juste, reviennent repartent, flottent, volent dans l’eau de mer, dans le monde du silence. C’est peut-être le plus incroyable, cette capacité à jouer silencieusement de la batterie qu’il détient. Une personne dans le public fait un malaise. Pompier. Evacuation. Probablement dégoutée par l’élégance si inouïe de ces individus qui n’ont rien d’autres à penser que la Musique, qui la font, qui la vivent, qui en vivent. Sacrés veinards qui avez ça dans le sang, aurait dit mon père. Mon père…. Manu Katché, un jour, avec Marcus Miller, l’a décoré de l’ordre de chevalier des arts et lettres. Il était encore en vie.
Alors surgit l’aspect à la fois terrifiant et agréable de ce concert : il est sépulcral. Des passereaux passent entre les pins. Ce sont des oiseaux psychopompes, conducteurs des âmes. Le vent lui aussi, glisse comme fantôme. La musique du quartet m’emmène dans l’au-delà où j’imagine l’auteur de mes jours. Figurez-vous un lounge bar de velours bleu. Mon père y traine, accoudé au comptoir, un petit verre de chartreuse à la main. La musique qu’il écoute, c’est celle qui se joue, là, maintenant. Et tandis qu’on applaudi chaque (nombreuse) étincelle émise sur la scène, comme à un spectacle de Marineland, quand l’orque saute et envoie des gouttelettes qui réverbèrent la lumière, étoiles au-dessus des enfants ravis, il est là, dans le fond, avec son sourire calme, simplement content d’écouter sa musique adorée. La sensation ne me quittera pas.
Entre certains morceaux, Benjamin Lackner évoque également ses racines, ses ancêtres. Son grand père parisien émigré en Californie. Son parcours à lui, l’artiste, sa dernière décade passée en partie près de Carpentras. Il joue un morceau éponyme, Last Decade. Manu Katché achève de tordre sa batterie avec la douceur d’un professeur d’Aikido. Puis le groupe laisse la place à la formation suivante. Applaudissements nourris.
Changement de plateau. Des gabians suspendus rentrent au bercail en couinant. La nuit est tombée, personne ne daigne la ramasser, on attend Dianne Reeves. Jingle Jazz. Rapide intervention du DA pour nous la présenter. Les musiciens s’installent, se mettent à jouer, avec la même facilité que les précédents. Ils posent une ambiance un peu plus latine de plage tiki-tiki, immense, caressée par l’écume, planches de surf plantées dans le sable. Au loin, des silhouettes en maillots dansent et rient, gout de sel sur la langue, les vagues battent comme un cœur.
Au milieu de cette sérénité, Dianne Reeves vient s’asseoir près du feu de camp, pardon, vient sur scène. Elle se pose sur la coque d’un petit bateau tiré hors de l’eau, avec une grâce de Dame, c’est dire avec simplicité et radiance. Aussitôt, elle chante sa joie d’être avec nous, dans une tradition d’improvisation juanlespinesque. Apôtre de la Bonne Nouvelle que l’on nomme Musique, sa voix part tout de suite dans des scats et des yodels que Billie Holiday et Ella Fitzgerald avaient émis autrefois pour la plus grande joie de l’humanité. Sa main guide sa voix, appuie sur des pistons invisibles qui donnent l’impression qu’elle joue d’un étonnant appareil : sa colonne d’air. Le seul instrument de chair et de sang dont les êtres humains sont équipés. Entre elle et ses partenaires, toujours cette aisance désinvolte de la pratique assidue d’un artisanat musical qui date de la préhistoire de la société du spectacle.
A un moment donné, elle demande poliment aux cigales de striduler un peu moins fort, et… Les cigales s’arrêtent net ! Comme leurs cousines de la pinède Gould, elles apprennent à chanter en rythme avec les artistes.
Ce qui est passionnant à observer d’ailleurs, c’est l’étonnant pouvoir que sa voix exerce sur la nature. Les échardes de cristaux qu’elle projette de haut en bas font réagir toutes les créatures. Une cantatrice chante avec elle depuis l’amphithéâtre, avec lyrisme, les cigales reprennent en mesure, les fans crient, même les mouettes répondent ! Oui, fascinant spectacle d’une tradition antédiluvienne et spirituelle, qui devait à voir avec l’imitation du chant des oiseaux C’est très difficile à exprimer. Jack Kerouac aurait pu le décrire avec des skoubs et des skib bi ba bip dou wa. En fait, Jack Kerouac aurait adoré, et aurait écrit là-dessus comme il se doit : avec rythme, style, beauté.
Song Yi Jeon, sa protégée, vient démontrer son talent. Elle aussi sait jouer du mystérieux instrument invisible avec brio. Son duo avec le suprêmement agile guitariste Romero Lubambo, en plus d’être une démonstration de force, est une mise en évidence de leur connaissance précise de la note, de son utilisation, de son organisation. Cela est presque un yoga vocal.
Mais cette musique si pleine d’ondes positives ne peut empêcher la mélancolie de me tomber sur la nuque comme une enclume. C’est exactement le genre que mon père aurait pu programmer au Sporting Club, alors les larmes me montent aux yeux. Et je me revois en costard dans la salle, mon badge de backliner autour du cou, la clope au bec, quand par l’immense baie vitrée la nuit brillait sur la mer, les sons laqués des synthétiseurs et des batteries insonorisées partaient en ricochet sur les éclats des flots. Des pleurs de sirènes partaient dans l’espace. Sur scène, derrière Dianne Reeves, il y a des rectangles de lumière qui ressemblent à des cartes à jouer. Par synesthésie, les cartes se transforment, la musique s’engouffre dans les couloirs du casino de la côte, ton univers… Mon cher papa tu avais ce monde à toi, cette passion conductrice que je n’ai su apprécier que du bout des doigts, du bout des lèvres. Ils sont fermés maintenant les coulisses, les changements de plateaux sur la scène, les kilomètres de câbles à enrouler. Je n’y suis pas. La cigarette devant l’entrée des artistes, le café dans les bureaux de la prod, il y en a plus non pour moi, qui suis un mollusque au fond de l’océan, blasé, fatigué, apathique, égotiste.
Et puis le show touche à sa fin. On fête l’anniversaire de Romero, il souffle la bougie sur le gâteau. Happy birthday to you général. Les deux versions, la classique et celle de Stevie Wonder. Avec Gina, on commence à rentrer pendant le rappel, les taxis sont rares et les mobibus de la RTM sans pitié. Ça bouchonne sur le chemin de la Fausse Monnaie.
Je repasse dans ma tête ce que je viens d’écouter, c’était d’une délicatesse et d’un raffinement qui contraste avec les sonorités produites à la tractopelle que l’on entend sortir des auto-radios. Vertige. La musique est un mystère. Plaisir, en général, thérapie pour certains, défouloir pour d’autre, combleuse de vide, remplisseuse de temps pour beaucoup. Pas question de jugement ici (tous les genres ont le droit d’exister), juste d’émerveillement devant la grouillance de cette engeance que l’on nomme humanité, et cette particularité qu’elle a de produire des sons, qui la font se trémousser et vibrer de façon presque magique, du plus fruste boumboum au plus sophistiqué baroque, du dodécaphonisme le plus déconcertant au beat le plus sucré de la pop, des roulements pleins de fièvre d’un piano romantique, aux sons numériques les plus froids, etc. etc. Cette faculté d’exprimer les émotions concrètement (si on veut bien accepter qu’une onde sonore est concrète), cette inexplicable volatilité éternelle, qui existera tant qu’une entité sentiente sera capable de codifier et de produire ces fluctuations de l’air, hors de tous les coups tordus du mercantilisme, (et surtout malgré eux), c’est beau comme la vie. Alors, même si chaque concert de ce genre sera le tombeau de mon père, tant pis. À l’heure où les chiens marchent encore sur leurs langues (à 23h30, il fait encore très chaud), je sens la vague des passions du vrai Romantisme, et ce n’est pas désagréable.
Superbe programmation ce soir, très émouvante.
Benjamin Lackner trio :
Benjamin Lackner : piano
Manu Katché : batterie
Jérôme Regard : contrebasse
Maciej Obara : saxophone
Dianne Reeves :
Dianne Reeves : voix
John Beasley : piano
Reuben Rogers : basse
Terreon Gully : batterie
Romero Lubambo : guitare
Special guest : Song Yi Jeon : voix