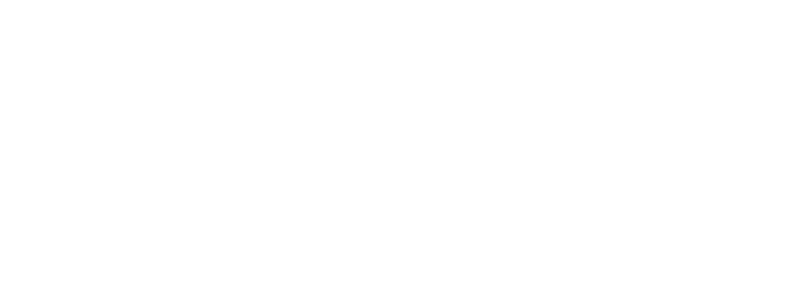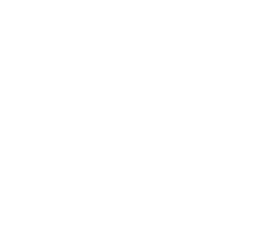La SEP
Quelques mois après, tout était terminé, tranquille, achevé, serein, mer d’huile. J’ai commencé à ressentir une douleur au plexus solaire. Ça me grattait, ça me piquait, ça me brûlait. Je rentrais du boulot, j’avais l’impression d’avoir un pieu planté dans la poitrine. Ça ne passait pas. Le toubib m’a dit que j’avais une gastrite. J’ai bouffé du Gaviscon. Ça faisait toujours mal. Je ne supportais pas le contact du tissu sur le creux de ma cage thoracique. On s’est dit, c’est peut-être le gluten. C’était la mode d’y être intolérant. J’ai mangé de l’argile. Toujours pareil. J’ai fait une endoscopie. Rien. Mais la souffrance ne prenait pas ses cliques et ses claques. Je fumais des tonnes d’herbe, ça m’anesthésiait, mais j’étais éclaté, comme une bombe à eau lâchée du cinquième étage. A trop chercher sur internet, ça menait au cancer du pancréas. C’était la signature familiale, j’ai méchamment flippé, Le docteur m’a fait faire une prise de sang, ce n’était pas ça. Apaisement mental, mais pas physique. Je ne sentais plus le bout de mes doigts. Vu un neurologue, fait une biopsie. On a dit fibromyalgie, le machin fourre-tout quand on ne sait pas vraiment ce qui ne va pas. Avec les Nitwits, on continuait les concerts, mais je sortais de là épuisé, ravagé. Après la démonstration, je tombais de mon siège, sans plus du tout de jus. On a essayé des alternatives, je jouais debout, façon Butthole Surfers, c’était un peu plus supportable, mais j’étais toujours aussi crevé. Matwis a quitté le groupe, j’en ai déjà parlé. Pour l’édition 2014 de Phocea Rocks, j’ai joué à l’Espace Julien avec the French Revolution, un groupe avec Cedric Trolux, Patrick Atkinson, et sa copine japonaise, Aya. C’était génial, une formation style Jon Spencer Blues Explosion, on ne se prenait pas la tête, on envoyait juste les watts. On se mettait des perruques poudrées et des tricornes, c’était fendard. Déjà, pendant les répétitions, je me sentais flancher, je n’arrivais plus à tenir. Les autres membres m’encourageaient de tout leur cœur, sur les passages difficiles, quand par exemple, il fallait tenir un beat country, un roulement de caisse claire continu. Toute ma bonne volonté y passait. Au café Julien, j’ai réussi, au prix d’un suprême effort, à tenir le set, mais une fois terminé, je suis sorti en titubant de la salle. Des mecs m’ont tenu la porte en se faisant des signes équivoques. « Il est complètement bourré lui. » Jord me vit, et me dit que ça n’allait pas, qu’il ne m’avait jamais vu dans cet état. Il m’a envoyé voir son beau-père, qui était un diagnosticien chevronné. Celui-ci fut effaré en me voyant : je faisais 48kg pour 1m93. Il m’a fait hospitaliser fissa. J’y suis resté un mois, à passer des examens, scanner, IRM, ponction lombaire, l’aiguille dans la vertèbre. Les toubibs faisaient des têtes de bergers allemands intrigués, je galerais à décrire ma douleur. À l’hosto, je vivais torse nu, mais même la moindre brise me mordait la zone sensible. Gin, ma mère, Pippo, Ritchie, Thomas, de Jack Error, Doberman, Reverend Hector Boom, venaient me voir. Thomas m’a filé la Maison des Feuilles, le livre dingue de Mark Z Danielewski. J’étais sous cortisone en perfusion, je l’ai dévoré en une nuit.
Puis on m’a renvoyé chez moi. Quinze jours plus tard, rendez-vous chez un neurologue de la Timone, qui a fini, après bien des détours linguistiques, par cracher le morceau : sclérose en plaque. Mon cerveau et ma myéline étaient striés de lésions. La gaine de mes câbles électriques avait été dénudée au hasard par des coups de canifs. L’influx nerveux ne passait plus, ma machinerie biologique était en panne. Une volonté de bodhisattva n’aurait pas suffi à me faire reprendre les commandes. Je me consumais comme la chaudière d’une locomotive, sans cesse avide de charbon à bruler. Les évanouissements, la schizophrénie, tout cela n’était que signes et leurres. Peut-être l’ennui était aussi un symptôme avant-coureur. Trop d’années passées crispé sur ma vie, d’envie d’en finir refoulée. Mon système immunitaire m’attaquait, je m’attaquais moi-même, une façon inconsciente de se suicider. Une sorte d’allergie au vivant. Passé ces considérations, ça faisait toujours mal. Très vite, je me retrouvai animal à trois pattes dès l’après-midi de l’existence. Allez-vous faire voir Œdipe et le sphinx. De toutes façons, il m’aurait bouffé. Ironie du sort, des années en arrière, j’avais acheté le bd de Mattt Konture « Sclérose en Plaques », attiré par le titre.
Avec Gin, on a changé d’appart pour un premier étage. On savait que j’allais être de plus en plus fatigué. Le déménagement et les travaux ont été un tel stress, que j’ai fait une méchante poussée : ma patte gauche s’est totalement bloquée. Elle s’est transformée, j’avais l’impression d’avoir une jambe de bois en béton armé. Long John Silver devenait d’un coup moins sexy, à vivre dans sa peau, je comprenais pourquoi il avait mauvais caractère : être gêné sans cesse rendait acariâtre. J’ai eu droit à la chaise roulante, mais cela m’était insupportable. A mi-hauteur des vivants, malgré les avertissements de Gin, qui me poussait, personne n’y prenait garde. Nombreux les tendons cisaillés par les repose-pieds. Quand, au bout de quelques années, j’ai réalisé que la fumette, malgré son efficacité antalgique, me sciait les guibolles, j’ai abandonné mon précieux plaisir. Je préférai marcher. La douleur ne me quittait plus. Tout les anti-douleurs, les opiacés, y sont passés. À un moment donné, j’avais de telles doses de Tramadol dans ma pharmacie, que j’aurais pu faire fortune en le revendant au Togo. Il m’a fallu deux ans pour décrocher de ce truc qui ne fonctionnait pas. Au boulot, ils ont été compréhensif, le télétravail était encore à ses débuts, j’ai pu en faire trois jours par semaine. Je pouvais encore profiter du métro marseillais et de ses escaliers, de son absence d’aménagement. Les rampants dans mon genre étaient priés d’utiliser les bus prévus à cet effet, à réserver quarante-huit heures à l’avance, et pas très ponctuels. Je voulais continuer de bosser à temps plein. J’ai fait contre mauvaise fortune coeur enragé, et j’ai continué de me frapper les marches de la station Notre Dame du Mont, en me faisant bousculer par les pimpants sexagénaires qui les gravissaient quatre à quatre, sans prêter attention à l’infirme à béquilles accroché à la rampe. Quand une main amicale se proposait de m’aider, c’était toujours celle d’un de ceux que ces mêmes personnes âgées qualifiaient de racaille.
On a arrêté les rats. Ces gentilles entités, meme avec les meilleurs soins, ne vivent guère au-delà de trois ans. Ces amis auxquels on s’attachait disparaissaient si vite, qu’au pic de notre fréquentation, il en mourrait un tous les six mois. Et la mort n’était jamais routinière, c’était toujours celle d’un être que l’on avait chéri. On avait l’impression de voir notre existence en accéléré : enfants vifs et joueurs, adolescents chamailleurs, adultes calmes et câlins. Quand la vieillesse arrivait, c’était le spectacle de la décrépitude. Ceux qui ne mourraient pas d’une énorme tumeur grosse comme un balle de tennis, mourraient d’usure. N’ayant plus la force de les ronger, leurs griffes grandissaient sans fin, la calvitie les gagnait, ils perdaient leurs poils. Ils maigrissaient de façon dramatique. Dans la main, ils donnaient la sensation d’un petit tas de brindilles, et puis un jour, ils se couchaient et ne se relevaient plus, l’appareil était hors d’usage. Tant de petites âmes, où allaient elles après ? Et nous, nous n’étions pas plus importants. Ça donnait le vertige.
Tout devenait épique. Les embûches, innombrables. La moindre action gênerait d’invraisemblable difficultés. Ouvrir une barquette de jambon, un emballage de bouillon Kub, serrer un bouchon, rouler une cigarette, sortir les clés de ma poche, saisir une pièce de monnaie tombée sur une surface plate, appuyer sur des touches, monter, descendre d’une voiture, tourner les pages d’un livre, brancher une prise, se glisser sous une couette, prendre une douche, enfiler des vêtements, des chaussettes, mettre mes chaussures, attacher mes lacets, emmener un chien chez le vétérinaire, porter un blessé, soutenir un mourant, aller de la chambre au salon, du salon à la cuisine, de Charybde en Scylla, le tout avec des épingles plantées dans le cœur, ce n’est plus de la torture, c’est une odyssée. L’aventure au quotidien. L’énergie. Juste assez pour bouger, pas suffisamment pour se mouvoir. Boire, me défoncer ? hors de question, ça ne me rendait qu’encore plus malade. Mon état préféré restait la position horizontale. Tandis que j’agonisais, l’inconfort était moindre. Il n’y a que lorsque je dormais, inconscient que ça allait. Mais chaque, matin je me demandais dans quel état j’allais me trouver. Pourrais-je marcher ? J’avais l’impression d’être une pomme de terre. Pomme de terre ou pas, quand on souffre on est ridicule. Le monde des humains n’est pas fait pour les tubercules, disait Blair. J’avais envie de rabrouer tous les français valides qui venaient se plaindre sous mon nez. Eux ils pouvaient marcher, courir, sauter, danser. Ils avaient deux jambes, qui pouvaient les emmener jusqu’au bout du monde, mais nombre d’entre eux se déplaçaient en trottinette. J’enrageais de mon enrôlement forcé, dans cette guerre contre la société des vivants.
Je tombais tout le temps, je tombais en me prenant les pieds dans les tapis, dans les cahots des rues, en me levant, en mangeant, en faisant l’amour. Je tombais d’en haut, d’en bas, en avant, en arrière, par la gauche, par la droite, je parvenais meme à tomber allongé, la chanson de Jacques Higelin « tombé du ciel » m’exaspérait. Je sentais le regard méfiant des autres, dans leurs yeux le dégoût de la faiblesse. On pensait souvent que je n’étais juste une loque titubante, donc droguée. Peu voyaient ma canne, tous ma non-conformité. La fréquentation d’un bar bondé m’était impossible, c’était un piège mortel, où je constatais que la vie ne tolérait aucun trainard. Marche ou soit broyé. Oh bien sûr, quand je pouvais discuter avec mes semblables, ils devenaient sympathiques, et vraiment concernés par ma condition, mais par défaut, ils s’en fichaient. Normal, je n’avais pas un gyrophare sur la tête pour prévenir de mon mal. Je sentais mon inutilité. Ne nous faisons pas d’illusions : quand le quatrième reich viendrait, je serais le premier à partir, pour reprendre les Dead Kennedys. J’ai continué d’annoncer les concerts sur la page PR, pendant quelques années. J’ai laissé tomber. J’avais trop mal.
Prisonnier d’une geôle de routine, où le moindre écart pourrait s’avérer dramatique, sur le bas-côté du monde, sur le banc de touche, je ne pouvais que le regarder tourner. Dans la rue, ou assis quelque part, à la terrasse du café, dans une salle d’attente, dans une gare, un train, un bus, un métro, je comptais le nombre de personnes le nez dans le smartphone. Quelles proies faciles. il n’y aurait qu’a les assommer, les dépouiller, et détaler. Peu se rendraient compte. Peste soit de mon handicap. Ils me semblent si dociles, si déconcentrées, si victimes potentielles.
Dans Marseille capitale de la douleur, je mourais de ne pas mourir. Vivotant dans l’obscurité, Je n’étais pas un élu de l’art. J’ai dû arrêter les concerts, et il a fallu du temps avant que je reprenne des baguettes. Aujourd’hui, je jouote sur une batterie électronique à la maison. Mon niveau est bien loin de celui d’avant, mais jouer cinq minutes tous les jours, c’était indispensable. La musique, tous les zicos vous le diront, on a besoin d’une dose, sinon on s’étiole. J’arrive à jouer « nazi punks fuck off » c’est déjà ça. Et les copains sont toujours prêts à taper le bœuf.
10 ans de musique, 10 ans de sep. Toujours cette douleur lancinante, permanente. Épuisé des le réveil. On s’y habitue, mais on ne s’y fait jamais. A 44 ans, j’ai l’impression d’en avoir 94. Avec les vieux, les vieilles, dans la rue, nous faisons la course de haies par-dessus les poubelles, nous nous escrimons en croisant nos cannes, nous déambulons dans le tiéquar, comme les guerriers du bronx. Fini ma douce fumette, impossible de marcher avec. Il me reste le rocksteady de Desmond Dekker. D’équerre, je le suis pas mal, et sans came. Cela paraîtra étrange aux artistes-peintres, mais ne pas recourir à l’aide de mes pairs est ma vengeance. Meme diminué, je n’ai pas besoin d’eux.
Ce qui me chagrine, c’est de me dire que je vais mourir au travail, a cause d’un gouvernement qui a forcé une loi de manière anti-démocratique. Pour quoi ? Faire des économies ? Des économies sur quoi ? Je ne constate pas de bien être prégnant autour de moi et de mes compatriotes, j’ai surtout l’impression que l’on nous dresse à devenir des gueux. Je n’ai demandé aucune aide de l’état. Suis-je le seul handicapé à travailler à plein temps ? Dans ce cas, donnez-moi une médaille et une pension à vie. Quoiqu’il en soit, merci, monsieur le président, merci de nous considérer comme une masse informe, taillable et corvéable à l’envie, merci, vous auriez au moins pu avoir la délicatesse d’autoriser l’euthanasie assistée. A quoi jouer à la loyale contre un adversaire qui définit les règles, et les changes dès qu’il risque de perdre ? C’est jouer au Monopoly avec un garnement de cinq ans. Il se sert dans la banque et saute par-dessus la case prison. Garnements de cinq ans, excusez-moi, je vous compare à plus bas que vous.
Tel un bovin, je passe mon temps à ruminer avec ma cervelle blessée. Je pense souvent à mon père. J’espère que j’aurais la chance de ne pas vivre plus longtemps que lui. J’ai toujours peur de finir à la rue et de mourir d’inanition, crasseux, aux abois, sans aucun savoir-survivre. Mortelle inquiétude, qui est certainement la source de mon auto-dévoration. Avec l’attitude que je viens de décrire, le destin sera certainement celui-là. Ou alors, on trouvera mon corps en état de décomposition avancée, dans l’appartement que j’occuperai, solitaire, oublié. J’aurais eu un malaise. L’odeur aura alerté les voisins. Comme tous mes compatriotes, je râle. Ce qu’on appelle l’information est en majorité du persiflage national. Au pays de la Liberté, tout ce qui procure du bonheur est prohibé, sauf l’alcool qui abruti et le sport qui discipline. L’état passe son temps à bidouiller la machine de la Chose Publique, cela revient à rafistoler un avion avec du fil de fer et du scotch : ça vole encore, mais c’est complètement déglingué. On peut mourir à tout moment. Les divertissements sont de sinistres abat-jours, on ne lève plus le nez pour regarder les nuages, on observe des agglutinements de nuages plats sur un écran plat. On parle du Meilleur des Mondes, et de 1984. Je trouve plus que nous sommes dans un Bonheur Insoutenable, d’Ira Levin, avec sa société contrôlée par un ordinateur unique, droguée aux antidépresseurs. Dans le monde U, on n’a pas a faire de choix, et tout le monde meurt au meme âge. Encore que contrairement à nous, les gens savent à quoi ils servent. C’est le mal du siècle, on n’arrive plus à se définir. Étranges décennies de révolte nationale qui n’éclate jamais. Que dis-je, des décennies, des siècles de ralala ! Et moi, que fais je ? Rien. J’ai peur de mourir. Alors qu’avec toute cette souffrance, je devrais y foncer tête baissée. Je suis français, je suis malade. « La politique, c’est la maladie des français » (René Char). Ou alors… La révolution est déjà là, et se mène en guerre secrète ? Dans ce cas, je ne dois rien dire, pour ne pas la trahir. Il me semble que nous ne nageons pas encore dans le bonheur, ni que les humains soient frères et sœurs.
« Eh ben alors Vinzo, si tu es mécontent, débrouille-toi pour tirer ton épingle du jeu, et réussir ! »
La réussite, je pourrais la chercher pour m’en sortir, vivre dans le confort. J’écris pas mal. Mais la réussite s’obtient à force de courses, disait Flaubert. Et moi, je suis boiteux. Impuissant à changer la face du monde, combien de milliards de page me faudrait-il écrire pour justifier des choses si simples ? Soyez cools, pas débiles ? Baiser c’est moins grave que tuer, et il n’y a pas que ça dans la vie. Mon existence me semble avoir été celle d’un Sisyphe bon marché.
Dans le mythe de Sisyphe, nous sommes Sisyphe. Il nous est attribué une pierre à pousser. Souvent, on a même le choix dans la pierre, elle s’appelle carrière (sans jeux de mot) : sport, science, finance, art, etc. Ce que vous voulez. Puis la partie commence : on la monte, on la monte, elle redescend, elle redescend. Parfois on parvient à la faire tenir en équilibre sur le sommet pointu de la montagne. C’est le succès Elle reste là, se balance doucement, des minutes, des heures, des jours, des mois, des années… Mais elle finit par basculer et rebondit avec fracas tout en bas. C’est ça la punition : on a cru à l’éternité, mais rien n’est éternel. Je n’ai pas vraiment envie de laisser des traces d’ongles sur la coque de l’histoire. Le bateau coulera bien assez tôt.
Pourtant, je n’aimerais pas être quelqu’un d’autre que moi, n’est-ce pas curieux ? Je peux pester, mais finalement, c’est de ma faute. J’aurais dû me battre, plutôt que de laisser faire et constater l’inégalité autour de moi. C’est mon schisme psychique. Je demeure ravi et atterré. Si on regarde de l’autre côté de la pièce, j’ai plutôt de la veine. Ces dix années de musique, ça valait le coup.
On n’a pas eu à se taper des labels débiles, des prod idiotes, et des managers à côté de la plaque, c’est plutôt cool en fait. Ça change des biographies d’artistes classiques. On a fait les choses humblement, certes, mais sans aucune entrave extérieure, et on a fait tout les trucs qu’un groupe rêve de faire : passer à la radio, signer des autographes, tourner à l’étranger, faire des interviews, enregistrer des disques, et surtout, faire des concerts. À notre décharge, on à jamais eu le melon surdimensionné, contrairement à d’autres formations dont je tairais le nom, en guise de punition. Ceux qui viendront me casser la figure pour cette raison se dénonceront ainsi.
Le but d’un groupe ou d’un compositeur /interprète est de faire des chansons qui restent dans la tête, où des pièces de virtuosité, quel que soit le genre. Le tout-venant, ou la prise du train en marche, ne donne au mieux droit qu’à quinze secondes de gloire. Mieux vaut laisser son travail prendre la poussière, et vieillir comme un bon vin. S’il ne dégoûte pas à la réécoute, c’est que ça valait la peine d’être enregistré, tant pis si ce n’est pas un tube interplanétaire. Quand je réécoute les disques ou je joue, Nitwits, Supertimor, Crumb, Doberman, je n’ai pas honte. Je rougis de fausse modestie, mais dans le secret, je suis content d’avoir joué sur ces morceaux, ce sont de bonnes chansons. « Mon Essentiel » par contre, c’est encore plus dégueulasse qu’avant. Ce qui m’aurait rendu très fier, c’est d’écrire un air qu’on aurait chanté aux fenêtres d’une prison, comme dans les Derniers Jours d’un Condamné. Mais oh, je ne suis qu’un batteur. J’en ai quand même une, de fierté : jouez « sgt Rosco » , sur le Marécage de la Mélancolie, aussi vite que moi, en une seule prise, sans ralentir. Attention, c’est mariole
Je suis plus gibi que shadok, j’aime faire des politesses et des amabilités juste pour le plaisir de les faire dans ces moments la douleur s’absente un instant. J’aime regarder les moineaux et les pigeons dans les arbres de la place. Toujours cette incapacité à comprendre mes semblables. Je soupçonne les signes, mais je ne puis y croire. Pourtant je ressens des émotions. Est-ce que c’est ça, être humain ? une boule de sensations sans cesse changeante ? Ce n’est pas bien grave. Comme je le disais précédemment, la scène est hyperactive, et je peux voir tous les jours des concerts à deux pas de chez moi. Deux pas, je peux les faire. Ce serait stupide de dire que les temps ont changé. On parle toujours des mêmes choses, mais avec des mots différents. Ils mutent, ils s’oublient, il faut reformuler. Ça occupe.
Depuis la maladie, je me suis concentré sur l’écriture. J’ai fini d’écrire Serat. Grace à Renaud Mossberg, il a été publié dans une belle édition. Ce livre, à cause de mon éducation ultra-classique, je l’ai voulu audacieux. Pour retranscrire le vacarme de la vie, j’ai fait ces passages simultanés, avec leurs mises en pages en colonnes. J’ai déformé les paroles de Wipers pour faire celle de la cassette. Je voulais dénoncer le racisme. Les serats sont biologiquement différents, ça justifie leurs haines. Nous humains, quelle excuse a-t-on ? aucune. Depuis, les mots se sont accumulés, ont pris la forme d’autres bouquins. C’est chouette.
En tant qu’écrivain, j’espère me trouver des ressemblances avec Von Kleist, dans le sens où l’on se retrouve désappointé à la fin de ses histoires et des miennes, on se dit, « ah bon ? tout ça pour ca ? Décevante, la fin. » Mais en fait, ces histoires vous travaillent, vous creusent la viande, surgissent au coin d’un bois, d’une fenêtre, de l’œil ou de l’oreille, et mine de rien, vous vous en rappelez. Quant au côté torturé, lui et moi, on aurait été champion de course en sac-tandem. Médaille d’or.
Je vieillis. Bérénice, Ligeia, Gin, elles vieillissent elles aussi. Pas la tendresse que j’ai ressentie pour elles.
Et la folie ? peut-être que je suis encore dedans. Dans cette époque, je me sens emberlificoté dans des myriades de cordes, comme Guilliver capturé par les lilliputiens. Ça vous le fait également ?
Et la mort ? Depuis que je souffre, je ne me suis jamais senti aussi vivant.
Suis-je encore un musicien ? Je ne sais pas. Je suis sensible aux émotions, de la meme façon qu’avant. La chair de poule en écoutant une certaine suite d’accords. Le pied tape, le corps, meme raide, se balance, le cœur gonfle, le fluide apaisant ou excitant se répand sur mon cerveau et dans mes veines, les larmes tambourinent à La porte des yeux. Des larmes de joie et de tristesse tout à la fois, que de garder en moi rend encore plus délicieux. Un état d’extaticité, électrisé de vie. Si j’étais un arbre je me déracinerais pour suivre Orphée qui passe.
La musique ne se classe pas par genre, mais par émotions, ou par sensations. Les émotions ou les sensations capturent tous les genres, coupent tous les sexes. Zouk triste, blues gai, metal amoureux, classique écervelé, techno désespérée, punk espoir, rock soucieux, rai méditatif, banghra piquant, stoner élévateur, seggae stimulant, oratorio comique, mambo mental, trap déprimant, dark wave sereine, bebop agressif, axé contrariant, kwaito impatient, frictions, pinçures, souffles, percussions, vibrations, silences admirables. Tous se mélangent comme des dés remués dans un sac. La juste juxtaposition entraine joie, épiphanie et soulagement. La musique, laissez la me percer le cerveau en profondeur, avec ses vrilles, en retirer des carottes de matière spongieuse, m’en délecter encore, encore, encore ! La musique est toujours la, la musique est là pour toi et moi. Et je ne parle que de cet art. C’est idem pour les autres.
Écrivant ces lignes à l’aube de la planète des singes, il faut que je conclue et me retire, ami lecteur, amie lectrice, je vous ai bien bassiné. Donc, toi qui est triste, sache que je suis là. Je n’ai pas de conseil miracle pour te sortir de là, mais sache juste que je comprends, oh oui, je comprends. Alors, même si je ne suis plus quand tu liras ces lignes, tu me tireras par la main, et je te parlerai. On sera dans le tour bus. Avec la bande, on te racontera des histoires de vieux briscards. On fera chanter la marmotte. La douleur aura disparu. Le camion s’arrêtera sur la départementale, près d’un champ frais, vert et confortable. On y descendra, et on cassera la croûte. On s’allongera dans l’herbe, le temps d’un petit joint. L’air nous chatouillera les narines, ca sentira le jardin à nous en faire frémir les poils de nez, on s’en gonflera les poumons et on soufflera un long soupir délassant. Des lamantins nageront dans la mer, au dessus de nous Je te dirai « T’inquiète pas, va. Oublie tes soucis cinq minutes. On est pas bien là, à rever aux nuages ? » Et on rêvera avant de reprendre la route.
Fini d’écrire le 5 mars 2024.